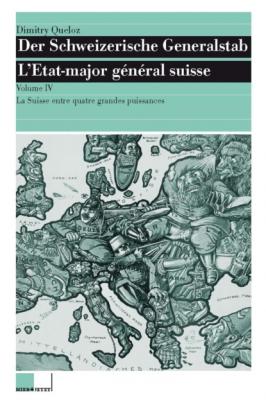ТОП просматриваемых книг сайта:
La Suisse entre quatre grandes puissances. Dimitry Queloz
Читать онлайн.Название La Suisse entre quatre grandes puissances
Год выпуска 0
isbn 9783039197989
Автор произведения Dimitry Queloz
Жанр Документальная литература
Серия Der Schweizerische Generalstab
Издательство Bookwire
2.2. Le Service territorial
L’organisation du Service territorial, définie dans l’ordonnance du 8 mars 1887, a été complétée et modifiée au début des années 1890.170 En 1891 fut fixée l’organisation de son personnel. L’année suivante, une nouvelle ordonnance fut édictée le 4 mars.171 Elle avait un caractère provisoire, car les changements qu’elle apportait le seraient à titre d’essai pour une période de cinq ans. Ce texte fut complété peu après par une instruction de service («Dienstanleitung») pour les fonctionnaires du Service territorial, émise par le Bureau d’état-major. La nouvelle ordonnance apportait deux changements importants par rapport à l’ancienne organisation. Tout d’abord, elle définissait un nouveau découpage géographique pour les arrondissements territoriaux qui passaient de 8 à 9, dont les limites étaient mieux définies:
– 1er Arrondissement territorial: Lausanne (cantons de Genève, Vaud, Valais)
– 2e Arrondissement territorial: Neuchâtel (cantons de Fribourg, Neuchâtel)
– 3e Arrondissement territorial: Berne (canton de Berne)
– 4e Arrondissement territorial: Lucerne (cantons de Lucerne, Nidwald, Obwald, Zoug)
– 5e Arrondissement territorial: Aarau (cantons d’Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure)
– 6e Arrondissement territorial: Zurich (cantons de Schaffhouse, Zurich)
– 7e Arrondissement territorial: St-Gall (cantons de Thurgovie, St-Gall, Appenzell Rhodes-Intérieures et Appenzell Rhodes-Extérieures)
– 8e Arrondissement territorial: Coire (canton des Grisons)
– 9e Arrondissement territorial: Bellinzone (cantons du Tessin, Uri, Schwyz)
La seconde innovation était la création des commandants du landsturm, un pour chacun des neuf arrondissements territoriaux. Directement subordonnés aux commandants d’arrondissement territorial, ils étaient à la tête des troupes du landsturm – 6 à 8 bataillons par arrondissement territorial – et de la landwehr de 2e ban, chargées de l’exécution des missions du Service territorial. Telles que définies dans la nouvelle ordonnance, ces missions ne présentent pas de différences notables par rapport à l’ancienne ordonnance et elles peuvent être regroupées en trois grandes catégories correspondant à des subdivisions distinctes du Service.
La première, relative à l’administration militaire du pays, était le fruit d’une coordination entre le Département militaire fédéral et les départements militaires cantonaux. Le nombre d’interlocuteurs – 25 au total – avec lesquels le DMF avait à travailler avait conduit à la création des arrondissements territoriaux qui devaient servir d’intermédiaires. La seconde mission consistait à assurer l’approvisionnement en hommes, en chevaux, en matériel, en nourriture et en munitions de l’armée de campagne et l’évacuation vers l’arrière de ce qui ne lui était pas ou plus utile, blessés, malades, matériel endommagé. Enfin, le Service territorial était chargé du maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur du pays, ainsi que de la protection des arrières et des flancs de l’armée de campagne.
Après une prise de contact avec certains des acteurs du Service territorial au cours de l’hiver 1890–1891, le Bureau d’état-major envoya, quelques jours après l’adoption de l’ordonnance du 4 mars 1892, un courrier aux chefs d’arme et de service du Département militaire fédéral concernant les tâches qu’ils avaient à réaliser en ce qui concernait ce service. De manière analogue, il écrivit, un mois plus tard, aux 9 commandants d’arrondissements et aux 9 commandants du landsturm. Les travaux concernaient notamment l’organisation du personnel, avec la constitution des états-majors172 et la mise sur pied du landsturm, ainsi que l’évaluation des ressources matérielles des différents arrondissements territoriaux, afin d’en préparer l’évacuation.
Selon l’ordonnance du 4 mars 1892, le Bureau d’état-major n’avait pas de contact direct avec les cantons en ce qui concernait le Service territorial, dont ils étaient pourtant d’importants interlocuteurs. Il était donc dans l’impossibilité d’influencer directement les travaux qui relevaient de leurs compétences, dont l’avancement était variable d’un canton à l’autre. Keller regrettait cette situation, car le Bureau d’état-major avait en charge les questions générales relatives au Service territorial. Il réussit en revanche à exercer son influence sur les commandants d’arrondissements territoriaux et sur les commandants du landsturm. Au cours de l’hiver 1892–1893, ces derniers suivirent les cours d’instruction de trois à cinq jours qu’organisa le Bureau d’état-major. Une bonne collaboration s’installa, de nombreux travaux furent réalisés et une règlementation mise au point, notamment une Instruction pour la préparation et la conduite des évacuations. Dans la seconde moitié des années 1890, deux grands domaines ont été pour la première fois l’objet de préparatifs: l’évacuation des dépôts des régions frontière («Grenzlagerhäuser») – Genève, Romanshorn, Rorschach et Buchs – et des quatre salines du Rhin. En 1899, Keller jugeait que le Service territorial avait réalisé les préparatifs nécessaires pour les cinq différents cas de concentration de l’armée qui avaient jusqu’alors été travaillés dans le détail.
L’ordonnance sur le Service territorial fut révisée le 8 février 1901 et est ensuite restée en vigueur jusqu’en 1909.173 Le nouveau texte était plus simple, plus précis et plus concis, mais il n’apportait aucun changement notable.
2.3. Le Service des chemins de fer et le Service des étapes
En dépit de l’organisation mise en place en 1887 et des travaux effectués par l’Etat-major général depuis 1874, de nombreuses lacunes existaient encore en matière de transport ferroviaire. Des exercices permirent de découvrir des problèmes très concrets. Les grandes manœuvres de 1894 montrèrent que les horaires de transport n’étaient pas bien faits.174 Ils n’étaient pas adaptés aux petites gares dans lesquelles les infrastructures – surtout les moyens d’embarquement – étaient rudimentaires. De plus, l’instruction des troupes et la conduite des activités dans les gares étaient jugées insuffisantes, conséquence des carences du règlement en vigueur. Dès lors, le Service des chemins de fer et le Service des étapes connurent d’importants changements, tant dans leurs structures que dans leurs méthodes de travail.
Les ordonnances du 4 mars 1892 et du 8 février 1901 ont apporté des modifications significatives dans l’organisation du Service des chemins de fer et dans celui des étapes. La première retirait aux commissaires des guerres des cantons le commandement d’étape initial.175 De plus, elle ne mentionnait plus le nombre des chefs de groupes d’exploitation. Enfin, changement le plus important, elle réorganisait le découpage territorial des groupes d’exploitation et en limitait le nombre à cinq:
– 1er Groupe: chemins de fer du Jura-Simplon
–