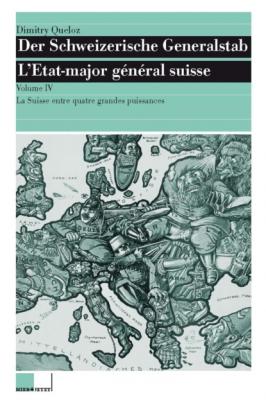ТОП просматриваемых книг сайта:
La Suisse entre quatre grandes puissances. Dimitry Queloz
Читать онлайн.Название La Suisse entre quatre grandes puissances
Год выпуска 0
isbn 9783039197989
Автор произведения Dimitry Queloz
Жанр Документальная литература
Серия Der Schweizerische Generalstab
Издательство Bookwire
Les deux périodes ont été abordées de manière thématique. Nous avons essentiellement travaillé par front. En raison du contexte politique international et de la situation géographique, nous avons distingué le front nord-ouest et le front sud. Le premier d’entre eux correspond bien évidemment au cas d’une guerre franco-allemande au cours de laquelle la Suisse pouvait être impliquée. Toutefois, l’Etat-major général a aussi envisagé la possibilité d’une action militaire directe de la part de la France ou de l’Allemagne. Nous verrons que la France a été perçue, pour diverses raisons, comme une menace particulièrement aiguë jusqu’au milieu des années 1880. Quant à l’Allemagne, une certaine méfiance est née à la suite de l’affaire Wohlgemuth, qui a montré que la neutralité helvétique pouvait être remise en cause par les Puissances.
La question du front sud est plus complexe. Elle ne se limite pas à la seule menace d’un conflit direct avec l’Italie. En raison de sa position géographique, la Suisse pouvait être directement impliquée en cas de guerre entre l’Italie et la France ou l’Autriche. Ce danger était particulièrement grand dans la première hypothèse, car les plus importantes lignes d’opérations entre les deux pays se trouvaient sur sol helvétique. De plus, la neutralisation de la Savoie pouvait également entraîner la Suisse dans les hostilités. Par ailleurs, la signature de la Triplice a fait naître un nouveau danger: celui d’un passage des armées italiennes à travers le territoire suisse, dans le but de coordonner l’action militaire germano-italienne contre la France. Dès lors, les chapitres relatifs au front sud comprennent également les thèmes en rapport avec le problème de la neutralité savoyarde et celui de la Triplice. Enfin, il faut encore dire deux mots du front est. Des quatre voisins de la Suisse, l’Autriche a été celui qui a été considéré comme le moins menaçant. L’Etat-major général a peu travaillé à l’hypothèse d’une guerre contre ce pays et la place qui revient à cette question se limite à la portion congrue.
La partie consacrée à la période 1890–1905 contient également deux autres chapitres. Le premier se rapporte à la nouvelle conception de la neutralité développée à la fin des années 1880, qui est née de la menace qui a commencé à peser sur son respect par les Puissances. Le second étudie les plans généraux de défense établis par l’Etat-major général. Ces plans correspondent aux préparatifs stratégiques destinés à jouer un rôle dans n’importe quelle situation de guerre. Ils comprennent les fortifications semi-permanentes en plaine, ainsi que les travaux découlant de l’importance stratégique du massif alpin.
4. Sources
Le fonds E 27 des Archives fédérales représente la première source employée pour cette étude. Il contient l’ensemble des documents émis par les différentes instances militaires au cours de la période: Département militaire fédéral, Etat-major général, chefs d’arme et de service, etc. Cette documentation a été complétée au moyen des informations recueillies dans les rapports annuels de gestion du DMF qui ont été dépouillés de manière systématique. La Revue militaire suisse, qui figure parmi les plus importantes publications militaires de l’époque, a également fait l’objet d’un traitement identique. Présentant de manière détaillée les différentes questions abordées, citant ou reproduisant, intégralement ou partiellement, des articles publiés dans d’autres périodiques militaires, la RMS a constitué une source particulièrement précieuse pour notre travail. Enfin, diverses publications de contemporains, livres, articles, ont également été consultées.
En ce qui concerne les relations internationales, nous devons beaucoup aux ouvrages publiés, dont nous avons donné une présentation au début de cette introduction. Nous avons toutefois eu recours à nombre d’autres documents. Il y a tout d’abord les publications contemporaines qui concernent particulièrement les conceptions relatives à la neutralité et à la question de la Savoie. Nous avons également travaillé sur divers documents d’archive, publiés ou non, pour compléter ou approfondir certaines questions. Les deux fonds E 2001 et E 2300 des Archives fédérales, ainsi que les Documents diplomatiques suisses33 nous ont fourni la documentation du point de vue suisse. Nous avons plus spécifiquement travaillé sur la correspondance échangée entre les représentations diplomatiques helvétiques à l’étranger et le Département politique.
L’étude des menaces étrangères nous a également conduit à étudier les documents des pays voisins de la Suisse. Concernant l’Allemagne, l’immense collection de documents diplomatiques publiés au lendemain de la Première Guerre mondiale par la Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte nous a été des plus utiles, notamment les tomes IV, VI, VII et XVIII.34 Pour l’Italie, les annexes des ouvrages, déjà cités, d’Antonello Biagini/Daniel Reichel35 et d’Alberto Rovighi36 ont mis à notre disposition divers plans, études et analyses des instances militaires de ce pays. Enfin, en ce qui concerne la France, nous avons utilisé trois fonds conservés au Service historique de la Défense, Département Terre à Vincennes: 1 M, 1 N et 7 N, ainsi que divers rapports des attachés militaires français dont nous avons réalisé récemment la publication.37
1. L’Etat-major général
1.1. L’Etat-major général avant 1874
L’Etat-major général a été créé en 1804, sous le régime de la Médiation.1 C’était un organe non permanent, coexistant avec un corps du génie permanent à la tête duquel se trouvait un quartier-maître, le colonel Finsler. Sa structure et les attributions de chacun de ses membres étaient à la fois compliquées et mal définies. Il connut en outre, à ses débuts, des difficultés d’organisation du fait de l’opposition de Napoléon à la nouvelle institution, celui-ci craignant de voir une force militaire organisée se reconstituer dans une Suisse dont il doutait de la sincérité du gouvernement.
Les différentes mises sur pied de l’armée, en 1805, 1809, 1813 et, surtout, en 1815, montrèrent toutes les insuffisances de l’organisation en vigueur. La répartition des tâches entre le major-général2 et le quartier-maître3 fut un des problèmes les plus importants à résoudre au quotidien. Le service de renseignements se révéla également tout aussi boiteux, tandis que le ravitaillement de l’armée, confié au commissaire des guerres en chef, connut des difficultés particulières, notamment au cours de la désastreuse expédition de 1815 en Franche-Comté.
Le Règlement militaire du 20 juillet 1817 créa un Etat-major fédéral du temps de paix, qui coiffait l’armée fédérale, composée d’une élite et d’une réserve. Nommé en partie par la Diète et en partie par